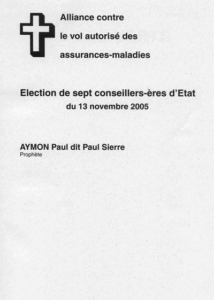A l’heure où la Suisse entière s’interroge sur le sort à réserver à Swisscom (opérateur national historique et public du pays), et décider si il faut privatiser ou non l’entreprise, mon interrogation personnelle porte elle sur un point en amont : à force de déblatérer autour du « besoin » d’un service public dans le domaine, s’est-on penché de savoir ce qu’est un service public ? Lorsque j’entends certains discours socialo-marxistes autour du besoin impérieux de garder Swisscom dans le giron étatique, non pas parce qu’elle fait partie des quelques entreprises rentables détenues par l’Etat, mais parce qu’elle serait aujourd’hui soucieuse de ne pas avoir une logique d’actionnariat propre au secteur privé, je me gausse. Ces individus sont soit totalement aveuglés par leur idéologie, soit n’ont jamais fréquenté un service d’Etat, et a fortiori Swisscom.
Pour le cas de Swisscom, il suffit de se rendre auprès de l’un des nombreux shops que possède le géant bleu : le débit doit être assuré, les clients qui posent des questions rapidement expédiés. Le vendeur passe trop de temps avec les clients, trop curieux ? Il se fait blâmer dès que son supérieur s’en apperçoit. Stress, rentabilité, efficacité, les contours du service public mériteraient d’être mis en exergue. Pour l’instant, je n’entends le téléopérateur se réclamer du public que lorsqu’on s’attaque au « dernier miles » (reliquat de sa position de monopoleur historique) : ce sujet pousse les dirigeants de l’entreprise à se draper d’habits de couleur rouge chaude, et à proférer une diatribe quasi-stalinienne. Cependant, hormis la défense de cet avantage particulier, la position est bien plus pragmatique, dirait-on. Tourné vers la rationalisation, devrait-on avoir le courage de dire.
Swisscom n’a à mon sens plus aucun lien avec le service public, et s’offusquer lorsqu’on parle de lâcher l’entreprise aux « chiens du privé » semble, encore une fois, totalement déconnecté de la réalité. Un combat d’arrière-garde. Surtout que, contrairement au domaine de l’énergie (électricité), il n’y a pas de raison d’Etat derrière. Beaucoup d’énergie inutilement gaspillée.
Swisscom est toutefois emblématique de la victoire de la doctrine néo-libérale. Elle s’est diffusée d’autant plus facilement chez Swisscom, qui est une entreprise soumise à la rude concurrence d’un secteur pleinement mondialisé; mais n’y a-t-il aucune répercussion des économies demandées par les « citoyens-contribuables » auprès des autres secteurs du public ?
L’assurance chômage, dans une schizophrénie dysfonctionnelle qui caractérise les services d’Etat suisses, permet l’intervention de la concurrence dans un secteur étatisé. Mais contrairement à l’assurance maladie (emblème de cette schizophrénie), l’Etat est lui-même en concurrence avec le privé. Tout citoyen qui demande à avoir accès à l’assurance chômage se voit proposer, lors de son inscription, un choix parmi diverses caisses de chômage. Ce choix semble peu important, au départ, puisqu’il s’agit d’élire un caisse qui aura le priviliège de payer l’assuré, après avoir calculé ses éventuels droits. Le placement, le contrôle de présence (anciennement le « timbrage »), sont effectués par un service d’Etat, les Offices régionaux de placement (ORP), qui est imposé à l’assuré. Après tout, il est normal que le contrôle soit effectué par les représentants des pouvoirs publics.
Pour le domaine du paiement, où un libre choix est possible, chaque caisse cantonale va subir la concurrence. Ce qui, à n’en pas douter, pousse les cadres de l’Etat, à rationnaliser, à rentabiliser au maximum leurs employés. Délire de gaucho ? Il faut que je partage ici une expérience personnelle. Je me suis rendu auprès de ce service pour entendre qu’on « ne peut pas vous consacrer autant de temps ». Saisi d’angoisse, jettant un oeil suspect alentour, mes oreilles s’étonnaient de ne pas entendre les quelques petites notes de la publicité de Swisscom. Pas autant de temps ?
Revenons quelques minutes en arrière, puisque j’ai pris la place sur le divan, place sur laquelle je n’aime pas m’appesantir dans mon blog. Mais puisque mon histoire – il me semble – dépasse la simple anecdote, je vais exposer la raison qui m’amenât auprès de ce « service public » si pressé de se débarasser de moi. Ca tient en 3 mots : comprendre le décompte. En effet, le service d’assurance chômage vous communique, lors de tout paiement, un relevé de compte : y figure le montant versé, le solde du délai-cadre (nombre de jours indemnisés), les retenues à titre de charges sociales, etc. Et il se trouve que, sur mon premier décompte, figurait une retenu vaguement justifiée par un article de la Loi sur l’assurance chômage. Après vérification auprès de cette loi, je ne saisissais toujours pas la relation qu’il pouvait exister entre la retenue opérée et le texte légal.
Naïvement, pensant que ce service public restait un service public, j’ai tenté de me faire expliquer les bases légales de cette retenue; enfer et damnation, me voilà rabaissé au rang d’emmerdeur, d’assuré (ou de client ?) pénible. L’Etat n’a pas que ça à faire; il faut payer les assurés, et ne pas perdre du temps à leur expliquer les tenants et les aboutissants de la loi. Encaisse et tais-toi, drôle d’auto-perception du service public. Mais il est vrai qu’on n’explique jamais le rôle primordial de l’Etat à ses employés. Quatre services, sept ans de *dure* labeur, rarement entendu les employés se soucier de l’aide qu’ils pouvaient apporter à la population. Plus encore rarement chez les cadres.
Alors me voilà devant cette dame au guichet, qui visiblement ne comprend pas ce qu’est une loi, ne sait pas la différencier d’une ordonnance, brandissant dans ma direction – comme d’autres brandiraient la bible – un recueil contenant loi, ordonnance, et explications, et s’impatientant : « Mais tout est là-dedans, monsieur ! ». Ceci après m’avoir montré des directives internes, qu’elle ne peut me photocopier, car à usage privé seulement; j’ai le tort d’insister, je veux connaître la base légale, et non simplement des notes pondues par quelques chefs de service.
J’ouvre ici la deuxième parenthèse de ce billet : dès l’instant que l’on demande à une personne de l’Etat de faire un effort, on ressent immédiatement quelle faveur immense celle-ci condescent à faire à notre égard. Mais plus encore, lorsque celle-ci prend sur elle, et nous aide malgré tout, il vaut mieux pour l’assuré – le client – qu’elle soit en mesure de mener à bien la tâche. Cette jeune dame, qui semblait plutôt sympathique au premier abord, a été capable de souffler d’impatience avec une régularité qui ferait pâlir d’envie un métronome. Cela parce qu’elle ne connaissait pas le côté juridique de son métier; ce qui, au demeurant, ne m’aurait pas posé de problème, puisque des gens sont engagés pour cela. Même qu’on les appelle des juristes. Fermons la parenthèse, et oublions à quel point les incompétents ne sont pas ceux qui ne savent pas, mais refusent d’avouer qu’ils ne savent pas.
Les mauvaises langues diront que les juristes sont des gens comme les autres, mais avec un coeur perdu entre le Nébraska et l’Alaska. Formule heureuse pour exprimer tout le mépris que certains d’entre eux peuvent avoir pour le simple mortel, celui qui ne fait pas parti du club des légisvores. Je m’oppose en faux, je suis à un quart juriste; peut-on vivre avec la perte d’un quart de son coeur ? J’ai demandé donc à ma charmante interlocutrice, de plus en plus impatientée par mon jusqu’au-boutisme, d’aller chercher un juriste, prenant bien soin de ne pas briser définitivement son ego, omettant de lui dire que j’en avais assez de lui expliquer que des directives ou explications générales n’équivalait pas à un loi. Elle s’éclipsa, certainement soulagée de se séparer de la présence d’un client – un assuré – tout ce qu’il y a de plus chiant.
Moins de vingt minutes plus tard (!), la voilà de retour, m’expliquant la juriste ne peut venir au guichet; « surtout pour si peu », ai-je été tenté d’ajouter. Mais le regard lourd d’ennui qu’elle me lançait me découragea immédiatement de toute pointe d’humour. Et ce avec tout le sérieux dont je pouvais faire preuve, que lui demandai de me relater sa conversation avec sa juriste, qui avait décidément trop à faire pour prendre deux minutes à m’expliquer des choses aussi basiques : un billet, sur lequel était grifonné un article de l’ordonnance sur l’assurance chômage, était le seul résultat visible d’une discussion qui devait avoir duré une vingtaine de minutes.
A nouveau embarqué dans ce qui ressemblait de plus en plus à une empoignade, je tentais d’expliquer que mon seul souhait était de consulter l’article montré sur ce post-it jaunâtre, et rien de plus. Que, « pitié », je ne voulais pas être le client chiant pendant plus longtemps. Rien à faire, la prédicatrice continuait à me mettre sous le nez son recueil de lois, m’expliquant que je savais tout, et qu’elle en avait assez que j’insiste.
Heureusement pour moi, ou peut-être n’étais-ce l’appel au ciel de cette dame qui l’entendais, mais toujours est-il qu’un homme, un peu plus sûr de lui, se décide à reprendre le « client chiant de la journée ». « Vous connaissez comment ça marche, la loi ? », me lance-t-il, avec un regard protecteur envers sa collègue. Mi-amusé, mi-agacé, je lui réponds que oui, peut-être même de manière méprisante. J’espère pas que ce dernier sentiment n’a pas transparu, tant cela m’est étranger.
Ma précédente camarade de jeu ne se fait pas prier, et s’en va immédiatement renseigner des clients plus affables, sans un regard vers moi. N’ayant pas particulièrement envie de mettre cela sur le tapis, je me fais lire l’article indiqué par la fantomatique juriste… ou plutôt son équivalent dans la loi. Ne le remarquant pas immédiatement, je commence à douter sérieusement des qualités de légaliste de la juriste, après avoir douté de ses qualités humaines. Lorsque… cette personne, pleine de bonnes intentions, m’avait lu la loi, et non l’ordonnance. Cependant, la négociation de la lecture de l’ordonnance aboutit avec ce preux chevalier, et me voilà enfin renseigné. Il m’a fallut une heure, montre en main, pour voir noir sur blanc pourquoi j’avais le droit à une retenue supplémentaire de chômage. Bon sang, je leur ai fait perdre leur temps, mais eux aussi me l’on fait perdre…
Ravi, soulagé, je tente maladroitement quelques justifications de mon opiniâtreté, explicant que vouloir comprendre n’est pas si condamnable, après tout. Un sourire convenu aux lèvres, le bonhomme se fend d’un « ouioui », impatient de me voir vider les lieux. A n’en pas douter, une fois dehors, mes deux anciens camarades de jeux ont dû se lancer un regard convenu, pousser un soupir de soulagement, et rire de tous ces emmerdeurs qui n’ont rien à faire de la journée, si ce n’est venir leur faire perdre leur temps. « Après tout, ces chômeurs n’ont rien à faire de la journée ».
Le simple fait de vouloir comprendre emmerdre tout le monde. L’Etat, machine bureaucratique habituée à pondre des décisions administratives comme d’autres s’allument une cigarette, ne réalise même plus que parfois, certains citoyens souhaiteraient comprendre ces décisions. J’avais conscience, dès le départ, que seule une chance infinitésimale pourrait me voir déboucher sur une lacune légale. Bien qu’ayant vu durant plus d’une année mon propre service émettre des décisions entièrement illégales à des centaines de personnes, j’étais conscient que ce type de carence reste assez isolé. Ce qui ne m’empêchait pas de… vouloir comprendre, simplement. J’aurais eu affaire à un juriste, l’affaire était réglée en deux minutes, et chacun aurait repris ses activités le plus naturellement du monde.
Cette longue histoire personnelle pour conclure ceci : cette schizophrénie de l’assurance chômage pousse ses employés à expédier presto leurs clients (et non leurs assurés). Outre le manque de connaissance juridique de cette dame qui avait tendance à la mettre en pétard elle-même, il ne serait pas étonnant que ses responsables lui demandent de ne pas dépasser un temps maximum avec les clients. Qu’il faut que « ça tourne », que les deniers publics sont engagés en l’affaire. Oui, mais si l’argent du contribuable est la source de tout financement, serait-il déplacé d’attendre compréhension et empathie du service, divulguant une information qui ne tiendrait pas de la faveur accordée, mais de la communication entre l’Etat et ses citoyens ? C’est du moins l’image que j’ai d’un service public. La valeur ajoutée, le plus propre à l’Etat : une conscience du rôle particulier qu’il a à jouer, un échange avec les citoyens qui dépasse le simple transfert pécunier.
En somme, voici que les services publics sont soumis à la concurrence, et se comportent comme n’importe quel acteur privé, dédaignant les débiteurs et déroulant tapis rouge pour les créanciers. Le concept « d’assuré » a été bouté par celui de « client ». Les cadres, source d’information plus fiable pour le public, ne prenent même pas la peine de se déplacer pour renseigner les clients : il faut faire du chiffre, et ne pas perdre de temps avec le service après-(ou pré)vente. Si dans le cas de Swisscom c’est compréhensible, car plus ou moins anoncé à la population (mais restant condamnable, discutez-en avec un employé du géant bleu), dans le cas des services publics… c’est inacceptable. Et pourtant, c’est le monde que le citoyen-contribuable demande à l’Etat de construire : plus froid, plus dur, et plus rationnel. Plus rentable, mais plus inhumain. C’est pas bon signe, à mon avis. Reste à voir si, les gens qui partagent mon avis en ce moment à la tête de l’exécutif de Genève, vont combattre et inverser ce flux semblant inexorable; rien n’est jamais inexorable.
Toujours est-il que, hormis mes plus posés camarades, je ne vois qu’une droite aveuglée par son idéologie de main invisible, rêvant de marché tout puissant, qui gagne sans cesse du terrain, et une gauche aux relents de stalinisme-oportunisme, croyant encore qu’un service public existe. Espéront que malgré ces deux yeux pochés, un semblant de raison émergera au milieu.